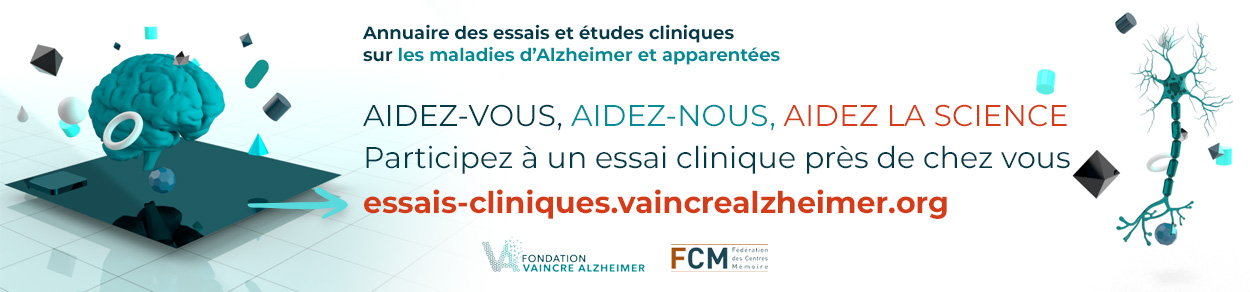Désigné Programme d’Actions destiné aux personnes souffrant de Maladie d’Alzheimer ou Maladies Apparentées, il est présenté en octobre 2001 sous l’égide de Elisabeth Guigou (Ministre de l’Emploi et de la Solidarité, gouvernement Lionel Jospin-2), Bernard Kouchner (Ministre délégué à la Santé), Paulette Guinchard-Kunstler (secrétaire d’état aux personnes âgées), Marie-France Guérin (DHOS) et Benoit Lavallard.
Etat des lieux et objectifs
Ce premier plan effectue un état des lieux sur :
- L’épidémiologie,
- Les stratégies de prévention potentielles (vasculaires, nutritionnelles, activités physiques et sociales)
- Les difficultés du diagnostic précoce, qui nécessite une démarche rigoureuse (« Cette démarche mobilise des moyens cliniques, paracliniques et des tests neuropsychologiques longs, et nécessite des compétences pluridisciplinaires » – ANAES) et une prise en charge médico-psycho-sociale, justifiée par l’existence de médicaments permettant de ralentir la maladie
- L’insuffisance du repérage des signes d’alerte
- L’absence de justification du dépistage (hors recherche)
- Le caractère indissociable du diagnostic et du projet de soins : prise en charge globale incluant formation, recommandations thérapeutiques, suivi, partenariat avec généralistes et spécialistes, prévention et traitement des complications somatiques et des situations de crise, et mise en place d’aides adaptées
- L’isolement du médecin traitant qui assure seul en 2001 la prise en charge de ces patients et l’insuffisance de la formation des généralistes aux dispositifs sociaux d’accompagnement
- L’impact familial (humain et financier) pour les familles, 75% des patients vivant à domicile, même à un stade avancé, et la nécessité du soutien aux aidants et du développement des accueils de jour
- Les souffrances liées à l’entrée en institution, et les conditions d’accueil rarement adéquates
- La recherche récente et non coordonnée, à dominance biomédicale, et l’insuffisance de l’évaluation des modalités d’aide.
Ce premier plan se fixe 6 objectifs :
- Identifier les 1ers symptômes et orienter
- Structurer l’accès à un diagnostic de qualité
- Préserver la dignité des personnes
- Soutenir et informer les personnes malades et leur famille
- Améliorer la qualité des structures d’hébergement et les renforcer
- Favoriser les études et la recherche clinique.
Pour répondre au 1er objectif, des actions de formation pour les médecins généralistes sont mises en place, avec l’élaboration de supports pédagogiques et documentaires et l’incitation au travail en réseau. 1,8 millions de francs sont consacrés aux actions de formation (DGS) et 0,5 million en 2001 pour la validation d’outils de détection par l’Inserm utilisables en ambulatoire.
C’est pour répondre au 2e objectif de structuration de l’accès au diagnostic que le plan prévoit le développement des consultations mémoire de proximité et l’identification des centres mémoire, de ressource et de recherche.
Consultations mémoire
Toute personne chez qui a été détecté un trouble cognitif doit pouvoir être adressée à une consultation spécialisée. Or en 2001, les consultations spécialisés (libérales ou hospitalières) sont fréquemment réalisées sans pluridisciplinarité ni mise en plans de soin, ce qui ne constitue pas un gage de qualité. Les consultations pluridisciplinaires existent mais fonctionnent de manière hétérogène et manquent de moyens. L’accès aux neuropsychologues est limité.
L’un des objectifs du plan est par conséquent de mettre en place des consultations mémoire pluridisciplinaires avec un bon niveau d’accessibilité.
Les missions des consultations mémoire définies par le plan sont :
- D’affirmer le trouble mnésique, de diagnostiquer avec fiabilité un syndrome démentiel et le type de démence, et d’identifier les situations justifiant le recours au CMRR
- De rassurer les « plaintes sans trouble » et de proposer un suivi
- De mettre en place le projet de soin et de l’articuler avec les professionnels de terrain sous forme d’un plan d’aide
- D’être un espace d’accueil des associations familiales, d’échange et d’innovation
- De participer au suivi des personnes malades en partenariat avec les professionnels de ville et hospitaliers (gériatres, neurologues, psychiatres…) et les professionnels médico-sociaux
- De participer à la formation des professionnels impliqués dans la prise en charge des personnes souffrant de troubles démentiels.
Centres mémoire de ressources et de recherche
Selon le 1er plan Alzheimer, la grande majorité des patients doit pouvoir bénéficier d’un diagnostic dans les consultations mémoire. Cependant certaines situations nécessiteront une expertise complémentaire. Il s’agit des sujets jeunes et des personnes présentant un profil pathologique complexe.
Le plan prévoit donc de développer, dans le cadre d’une procédure de labellisation, des Centres mémoire de ressources et de recherche (CMRR).
Les missions des CMRR sont les suivantes :
- Recours pour les consultations mémoire pour les cas difficiles
- Consultation mémoire pour le secteur géographique
- Développement de travaux de recherche
- Formation universitaire
- Structuration d’un dispositif interrégional en partenariat avec les consultations mémoire
- Création d’un espace de rencontres éthiques
Le plan prévoit le renforcement en moyens humains et matériels des centres existants dans le cadre d’une procédure de labellisation, et l’élaboration d’un cahier des charges des centres mémoire de ressource et de recherche. Un budget de 5 millions de francs est provisionné par l’Objectif National de Dépenses d’Assurance Maladie (Ondam).
Circulaire du 16 avril 2002
La Circulaire du 16 avril 2002 concrétise le 1er plan Alzheimer 2001-2004 en créant les consultations mémoire et les centres mémoire de ressources et de recherche.
Consultations mémoire
La Circulaire du 16 avril 2002 déclenche le recensement (déclaratif) des structures existantes par les Agences Régionales de l’Hospitalisation (ARH), et le renforcement des structures existantes remplissant les missions et accueillant au moins 50 à 100 nouveaux patients par an. L’objectif de cette circulaire est que les consultations mémoire respectent le cahier des charges dans les 3 ans.
Le cahier des charges initial des consultations mémoire va poser les bases d’une organisation qui n’a pas beaucoup évolué depuis. Une consultation mémoire doit disposer :
- D’une équipe pluridisciplinaire composée, selon le cas, à temps plein ou à temps partiel, d’un gériatre ou neurologue, avec la possibilité de faire appel à un psychiatre ; lorsque coexistent dans un établissement de santé des consultations organisées à la fois en neurologie et en gériatrie, il est souhaitable qu’elles puissent coordonner leurs activités
- D’un personnel (infirmier, travailleurs du service social) chargé de l’accueil, de la coordination des intervenants médico-sociaux et du recueil de l’activité
- D’un personnel, de préférence des neuropsychologues, chargé de faire passer les tests et d’assurer le soutien psychologique ;
- De moyens paracliniques : tests neuropsychologiques et accès organisé à l’imagerie cérébrale ;
- D’outils de suivi d’activités comprenant au
minimum :
- le nombre de patients suivis ;
- le nombre de nouveaux patients ;
- les diagnostics ;
- les stades de la maladie ;
- la durée de la prise en charge ;
- les motifs d’arrêt du suivi ;
- le nombre de réunions pluridisciplinaires ;
- le nombre et le type de formations organisées ;
- les partenariats développés ;
- Et pour chacun des patients : l’âge, le sexe, l’origine géographique, le niveau d’études, la situation de famille, le lieu de vie, le mode de vie, la date de début de la maladie, le MMS, les résultats neuropsychologiques.
La consultation mémoire doit être implantée dans un établissement de soins de court séjour et pouvoir avoir accès autant que possible à des places d’hospitalisation de jour qui permettent de regrouper en un lieu et sur une journée tous les examens nécessaires et éviter une hospitalisation classique à chaque fois que celle-ci n’a pas de justification médicale. Elle doit disposer d’un ou de centre(s) de recours, avec lesquels la consultation coopère pour les cas complexes.
Centres mémoire de ressources et de recherche
La Circulaire du 16 avril 2002 enclenche la procédure de labellisation des CMRR en fonction du cahier des charges (une dizaine dans premier temps, à vocation interrégionale).
Le cahier des charges des CMRR est plus exigeant que celui des consultations mémoire. Les CMRR doivent :
- Obligatoirement être implantés au sein d’un CHU
- Disposer d’une équipe médicale pluridisciplinaire comprenant notamment : neurologue, gériatre, psychiatre ;
- Disposer de neuropsychologue, infirmièr(e), orthophoniste, assistante sociale, secrétaire, attaché(e) de recherche clinique et, si possible, ergothérapeute.
- Avoir un accès organisé à un équipement d’imagerie par résonance magnétique ;
- Avoir un accès organisé à l’imagerie fonctionnelle telle que la TEP
- Développer des travaux de recherche appréciés à partir des éléments suivants : publications dans des revues internationales ; communications dans des congrès internationaux ; participation à des conférences invitées ; participation à la rédaction de chapitre d’ouvrage ; collaborations scientifiques internationales ; subventions de recherche obtenues.
- Développer une activité de formation universitaire appréciée à partir des éléments suivants : participation à des formations initiales (DU, DIU, capacité…) ; participation à des formations continues ; publications à caractère pédagogique.